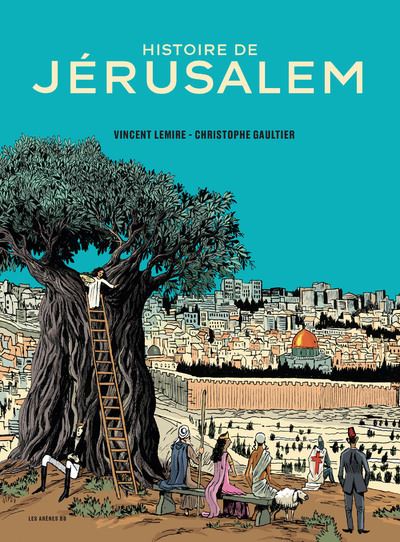Le silence de l'agneau
Rédigé par Métro-Boulot-Catho -Un passage en librairie il y a quelques semaines m'a fait tomber sur le livre de Matthieu Poupart, Le silence de l'agneau, sur lequel j'avais lu plusieurs réactions plutôt positives. Le propos me paraissait prometteur. Le livre me laisse mitigée.
Rappelons l'origine et l'intention de ce livre. Dans le rapport de la CIASE, les auteurs pointaient quelques uns des facteurs qui avaient favorisé les abus et qui autorisaient le terme "systémique" employé par eux. D'une part, soulignaient-ils, l'enseignement de l’Église catholique juge plus grave une relation homosexuelle entre deux adultes consentants qu'une agression sexuelle. D'autre part, le rapport suggérait que les agressions sexuelles ne devraient pas relever du sixième commandement (manquement à la chasteté), mais du cinquième commandement (meurtre). Autre problème, l'insistance de l’Église sur la miséricorde pour le coupable conduit à minorer la souffrance de la victime.
Le sous-titre du livre pose donc la question : la morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ? Pour y répondre, Matthieu Poupart analyse différents documents, et plusieurs témoignages de victimes viennent ponctuer et nourrir la réflexion.
Pour commencer j'ai été (désagréablement) surprise que l'auteur ne soit pas réellement présenté sur la quatrième de couverture. On saura seulement qu'il est engagé auprès de victimes d'abus et membre du collectif Agir pour notre Église. Cela ne dit pas grand'chose de son parcours, de sa situation et de sa formation (en théologie morale en particulier). Dans les interviews que l'on peut trouver de lui sur Internet, il est présenté comme "chercheur", mais on ne sait pas en quoi.
Vient ensuite la question des sources utilisées. Il n'existe pas d'ouvrage qui rassemble l'enseignement de l’Église sur la morale sexuelle (comme le Compendium de la Doctrine sociale de l'Église par exemple). Il faut donc constituer un corpus de textes. Et le problème, c'est que l'auteur ne justifie pas sa sélection : nulle part il n'explicite les critères qui lui ont fait retenir tel auteur ou tel texte.
Or il me semble que cet ensemble manque de cohérence et, pour une part, de pertinence. Sur des supports très divers (et de degrés d'autorité bien différents), l'auteur propose des analyses elles aussi très inégales. En vérité, on ne sait pas très bien ce qu'il a voulu faire : il se défend (dans une interview récente) d'avoir voulu faire un livre de théologie, quoiqu'il propose tout de même une analyse d'extraits de Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin ou Jean-Paul II, sans qu'on sache bien quelle connaissance il a de leur oeuvre.
Mais, affichant l'intention d'étudier "la pastorale" de l'Eglise, l'auteur retient plusieurs supports dont on peut penser qu'il les juge représentatifs. Pour autant, les choix montrent plutôt une connaissance partielle, et biaisée par les réseaux sociaux, de cette "pastorale". En témoigne le traitement réservé à une conférence de Pierre-Hervé Grosjean, décortiquée dans les moindres détails. Or, je n'ai jamais entendu personne (dans la vraie vie) qui se réfère au Padreblog. Son audience me parait assez faible en dehors d'un certain milieu catholique très connecté, propre aux aumôneries étudiantes de quelques grandes métropoles. C'est encore plus vrai concernant les manuels d'éducation affective dont il est question dans le premier chapitre. En 13 ans d'enseignement dans l'enseignement catholique (sous contrat), je n'ai jamais vu ni entendu parler de ces manuels dans les établissements que je connais ou dont je peux avoir des échos. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas : j'en ai - moi aussi - vu des photos dans des threads accusateurs sur Twitter. Mais l'utilisation de ces publications me parait, là encore, limitée à quelques milieux spécifiques. Les réseaux sociaux ont donné à leurs détracteurs une caisse de résonance disproportionnée par rapport à leur audience réelle. Honnêtement, je ne comprends pas l'importance que Matthieu Poupart leur donne.
Le travail sur les extraits bibliques, notamment l'histoire de Tamar ou Abram face à Pharaon, est un peu plus convaincant, et en tout cas certainement original. Presque frustrant : il mériterait en fait un livre à lui tout seul, qui non seulement analyserait les passages bibliques concernés mais aussi l'usage qui en a été fait au cours de l'histoire de la théologie morale. Un corpus d'extraits bibliques ne serait pas exhaustif mais il aurait au moins une cohérence intrinsèque.
Les derniers chapitres sur la persistance d'une culture du silence dans l'Eglise sont plutôt convaincants aussi. Sur ce point, il est plus évident que Matthieu Poupart a "des billes", comme en témoignent les extraits de témoignages de victimes longuement cités.
La conclusion, quant à elle, est à mon avis la meilleure partie de l'ouvrage. La thèse défendue est que ce n'est pas la morale catholique dans son ensemble qui porte à la violence sexuelle, mais que des éléments toxiques y demeurent qui donnent aux agresseurs des justifications ou des excuses dont ils savent (ab)user.
On pourrait élargir l'étude en approfondissant la dimension historique : travailler sur ce qui a fait évoluer l'enseignement moral de l’Église, au point que des prêtres en arrivent à condamner davantage la victime de viol que le violeur. Des pistes sont à creuser. Par exemple, je pense au rôle des grandes "hérésies" (catharisme, protestantisme, jansénisme) qui ont influencé (je ne saurais pas dire dans le détail de quelle façon) le discours moral(isateur) de l'Eglise, ou aux circonstances dans lesquelles Napoléon Ier rétablit l’Église en France (le clergé endosse alors en partie le rôle d'une police des mœurs bourgeoises et patriarcales : l'exaltation de la virginité féminine y tire une bonne part de ses racines).
Un autre angle mort que je regrette concerne l'enseignement dispensé aux séminaristes, à peine évoqué. Il aurait été intéressant de pousser la porte de quelques séminaires pour travailler sur ce qui est enseigné aux séminaristes (sur le sujet), et ce qu'ils en retiennent. Il me semble que c'est une clé du problème, parce que c'est là que se forge le discours moral que les fidèles entendent effectivement. Un prêtre est un homme célibataire formé au milieu d'autres hommes célibataires par d'autres hommes célibataires, qui eux-mêmes ont été formés au milieu d'autres hommes célibataires par d'autres hommes célibataires, etc. C'est une véritable endogamie intellectuelle, creuset de bien des dérives (comment tant de prêtres en sont-ils arrivés à croire, par exemple, que "les enfants (abusés) oublient" ce qu'ils ont subi, sinon parce qu'ils n'ont jamais été formés correctement à la psychologie de l'enfant ?). Je ne dis pas qu'il faut des prêtres femmes, mariés ou pères de famille ; je dis qu'il faut davantage de femmes, d'hommes mariés ou pères de famille dans le corps enseignant qui forme les prêtres. La pastorale ne pourra qu'y gagner.
Ces dernières réflexions dépassent sans doute l'intention de Matthieu Poupart, mais il aurait été à propos d'approfondir l'analyse sur la formation des prêtres.
Finalement, ce livre laisse une impression compliquée à exprimer, comme en témoigne la difficulté que j'ai eue à rédiger cet article. Plusieurs pistes sont à peine explorées et la pertinence de certains choix est discutable. Pour autant, quelques phrases particulièrement fortes montrent de sa part une finesse d'analyse qu'il sera intéressant de retrouver à l'avenir.
Pour aller plus loin :
une analyse du livre par Sixtine Chartier dans La Vie
une interview de l'auteur, déjà citée (45 minutes environ)
[ajout 13 janvier 2025] une critique approfondie, par le père Pascal Ide, de la lecture faite par Matthieu Poupart de la théologie du corps de Jean-Paul II, avec une réponse de Matthieu Poupart et la réponse de Pascal Ide à la réponse de Matthieu Poupart. (relisez la phrase lentement, ça va bien se passer !)

 Il est des auteurs dont le verbe, tellement ciselé qu'il en a l'air presque anodin, est si puissant qu'une seule phrase suffit à saturer votre capacité d'absorption.
Il est des auteurs dont le verbe, tellement ciselé qu'il en a l'air presque anodin, est si puissant qu'une seule phrase suffit à saturer votre capacité d'absorption.